22/05/2012
Robert Bober
 Robert Bober, Laissées-pour-compte (P.O.L., 2005)
Robert Bober, Laissées-pour-compte (P.O.L., 2005)
Les vêtements ont-ils un nom, une âme, une mémoire ? On serait tenté de répondre par l'affirmative après la lecture de ce roman très original qui se déroule entre 1949 et 1964. Ainsi, trois vestes racontent leur histoire : Y a pas de printemps (l’étudiante), Un monsieur attendait (le monde du théâtre) et Sans vous dont l’histoire n’est révélée qu’à la fin du livre. Un prétexte original pour dire l’éphémère du temps qui passe dans un Paris d’autrefois – ponctué par des extraits de chansons de l’époque - avec beaucoup de chaleur, de tendresse et de poésie. En refermant ce livre, vous éprouverez peut-être des remords à jeter vos vêtements usagés…
Egalement disponible en format de poche (coll. Folio/Gallimard, 2007)
11:22 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
14/05/2012
Yves Navarre
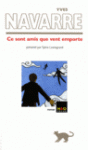 Yves Navarre, Ce sont amis que vent emporte (Flammarion, 1991 et LGF, 1994 - épuisés)
Yves Navarre, Ce sont amis que vent emporte (Flammarion, 1991 et LGF, 1994 - épuisés)
Et si Ce sont amis que vent emporte n'était pas un roman de mort - une phase terminale de sida - mais de vie? Ni moralisateur, ni militant, ce texte bouleversant évite soigneusement les clichés, les poncifs, les tabous. L'histoire de Roch - un sculpteur - et de David - un danseur - est surtout une histoire d'amour avec les hauts et les bas propres à tous les couples. Le temps des choix aussi, du crépuscule et de la mémoire. Un style volontairement épuré pour dire les sept derniers jours de David. Déchirant.
Nous ne serons jamais assez grands pour notre liberté (...) notre génération s'est perdue dans l'ambiguïté et le tapage. (Yves Navarre, sur http://culture-et-debats.over-blog.com)
disponible aux Editions H&O (2009)
09:23 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Yves Navarre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
05/05/2012
Marc Michel-Amadry
Bloc-Notes, 5 mai / Les Saules

Etes-vous tentés par une lecture agréable, sympathique, qui distille des pilules de bonheur comme d'autres un remède contre l'urticaire? Alors, vous voilà servis par ce premier roman écrit par un certain Marc-Michel Amadry, Deux zèbres sur la 30e Rue.
Au début de cette histoire, voici James, un fataliste, un peu désabusé, qui s'est fabriqué une carapace, depuis que sa femme l'a quitté, sans que par ailleurs cela l'attriste vraiment. Il est reporter - entre autres - au New York Times. Ce dernier lui demande d'effectuer un reportage à Gaza, et là, il rencontre un homme qui va changer sa vie: Mahmoud, un monsieur aux grands yeux bleus, d'une cinquantaine d'années qui n'arrête pas de sourire sous sa barbe grisonnante. Il est directeur du zoo de la ville et sa célébrité locale, il la droit à deux zèbres plutôt curieux, aux lignes noires et blanches un peu bizarres qui amusent les enfants de Palestine et déclenchent chez tous - y compris James - un irrésistible fou-rire communicatif, car ils hénissent... en successeurs pauvres de deux vrais zèbres morts de faim à la suite d'une offensive israélienne.
Son zoo, Mahmoud l'appelle le zoo de la joie: Il avait compris que sans magie, la vie n'est rien. Sans utopie, le cynisme gagne. Mahmoud, à lui seul, redonnait espoir en l'humanité. Et James se décide à l'aider. Il s'empare de ce fait divers qui est pour lui davantage qu'un symbole: une source capable d'insuffler du rêve et un sentiment de paix dans la vie de chacun. Ainsi donc, ils se rendent tous deux à New York où à travers un réseau de personnes influentes, leur est promis le don d'un couple d'éléphants, des lions, des antilopes, une girafe, des buffles et même - le top pour Mahmoud - un rhinocéros...
Mais la magie ne s'arrête pas là, car ces deux amis vont croiser leur chemin avec trois autres personnes dont le destin sera scellé par l'histoire de ces deux quadrupèdes un peu louches de Gaza: Jana, en première ligne, une DJ volcanique fascinée et émue par le récit de James trouvant son salut dans ce trompe-l'oeil zoologique, séduite par sa capacité d'émerveillement: Cet homme n'avait rien de lisse, la vie l'avait taillé à coups de serpe et poli avec un papier de verre très grossier. Elle aimait en lui cette rugosité, son caractère entier et son goût d'absolu.
Puis nous rencontrons Mathieu, consultant pour un cabinet de stratégie, follement épris de Mina, une artiste-peintre qui redoute de s'engager dans leur histoire d'amour naissante: Elle lui donnait du courage et l'envie de partir à la conquête de l'inaccessible. Depuis qu'il la connaissait, il voulait décrocher la lune, et même mieux: les anneaux de Saturne, pour que sa bien-aimée puisse jouer au hula-hoop avec eux. Pour la séduire, il choisira de lui écrire une histoire: celle de ces drôles de zèbres...
Ce récit ressemble à un conte pour grandes personnes, plein de charme et d'éclat, à l'humour un peu décalé, d'une tendresse légère qui réconcilie avec les humeurs du monde. C'est aussi un merveilleux roman d'amour où la petite histoire rejoint la grande. Jana confiera à James: Si on se marie, j'aimerais qu'on le fasse dans un zoo. Devant le parc des zèbres. Et Mila, sous un autre angle, ne dira pas autre chose: Mathieu et moi, nous sommes plus que jamais ces drôles de zèbres. Nous avons toujours été différents des autres, à vouloir vivre nos vies en dehors des conventions, en nous sentant libres.
Un petit bijou que ce livre et un cadeau idéal pour la Saint Valentin!
Marc-Michel Amadry, Deux zèbres sur la 30e Rue (Héloïse d'Ormesson, 2012)
00:24 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2012
Vénus Khoury-Ghata
Bloc-Notes, 22 avril / Les Saules

Vénus Khoury-Gata occupe une place discrète dans la littérature française. Pourtant, cette romancière et poétesse née en 1937 au nord du Liban - qui a reçu le Goncourt de la poésie en 2011 - a déjà signé une quarantaine d'ouvrages, parmi lesquels son Anthologie personnelle (Actes Sud, 1997) Les obscurcis (Mercure de France, 2008) et Où vont les arbres (Mercure de France, 2011) consacrés à la poésie. De ses oeuvres en prose, La maison aux orties (Actes Sud, 2006) et Sept pierres pour la femme adultère (Mercure de France, 2007) méritent de retenir l'attention.
Avec Le facteur des Abruzzes, publié au début de cette année, nous est raconté le voyage de Laure partie sur les traces de Luc son mari, mort dix ans plus tôt. Biologiste, il avait fait trois séjours à Malaterra, revenu avec une centaine d'éprouvettes et des prélévements effectués sur des Albanais implantés dans la région depuis des siècles, tous dotés d'un même groupe sanguin, O négatif. Dans un premier temps observée avec méfiance par les gens du village, elle fera connaissance avec le facteur Yussuf - qui parle de sa bicyclette comme d'une femme - le boulanger Mourad - aux bras qui sentent le feu de bois et une poitrine qui sent la farine chaude - ainsi qu'avec le bouquiniste kosovar qui lui souhaite la bienvenue dans l'enfer de Malaterra. Au coeur du récit, avec son lot de secrets bien gardés et de ses superstitions, s'impose Helena - muette comme le bois de son fusil, comme la margelle de son puits - qui a pendu sa fille deshonorée au figuier du jardin, réclamant son dû depuis trente ans qu'elle est sous terre.
Confrontée aux images d'un Luc qui lui était étranger - il aimait le raki, fumait le narguilé et jouait au trictrac avec les hommes - Laure se réfugiera dans ses notes qui ressemblent à la mousse sur une tombe non entretenue, s'éloignant peu à peu du but de son étrange pélerinage au nom de celui qui appartient désormais à celles qui le nourissaient et le faisaient rire auprès de ses frères en insoumission.
Ce roman est truffé d'images sensuelles respirant l'authenticité, telles la réflexion du bouquiniste sur le livre: Il n'est pas nécessaire, dit-il, de lire un livre pour en connaître l'histoire. Les légendes circulent mieux à l'air libre, elles voyagent sur la voix, de bouche en bouche, de pays en pays. Les légendes n'ont pas besoin d'alphabet pour exister. Il faut regarder les pages comme on regarde une personne aimée, suivre les lignes du doigt sans essayer d'en déchiffrer l'écriture. Pareil à un animal familier, le livre a besoin d'être apprivoisé. Il faut le humer, le toucher, le caresser dans le sens du poil pour le connaître.
Un brin philosophe, Yussuf ajoute, à propos du langage: Mettre les mots sur des mots ne construit pas une maison, ne fait pas grandir un enfant ou un arbre, ne laboure pas un champ ni n'empêche les sauterelles de dévorer toute une récolte de maïs. Les pages qu'on écrit sur une table ne changent pas la forme de la table mais font exploser le cerveau de celui qui écrit. trop de mots fissurent le crâne et raccourcissent la vie.
Le facteur des Abruzzes rappelle par son atmosphère le roman de Sylvie Tanette, Amalia Albanesi, paru chez le même éditeur, voici un an, et qui a fait en son temps l'objet d'une présentation dans ces colonnes.
Tout me ramène à toi parmi ces gens qui ne te connaissent pas, ne te ressemblent pas, ne parlent pas la même langue que toi... Mon pauvre amour, me pardonneras-tu un jour d'avoir manqué de temps pour t'aimer? Mon amour, souviens-toi de nous... se confie Luc dans une lettre à Laure qui ne quittera jamais les Abruzzes. Un autre mystère caché dans les arbres de Malaterra...
Une bien belle histoire, servie par une écriture chaleureuse et pleine de grâce, comme on voudrait en lire plus souvent!
Vénus Khoury-Ghata, Le facteur des Abruzzes (Mercure de France, 2012)
11:20 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
11/04/2012
Morceaux choisis - Henry Miller
Henry Miller

Le meilleur de l'art d'écrire, ce n'est pas le mal réel qu'on se donne pour accoler le mot au mot, pour entasser brique sur brique; ce sont les préliminaires, le travail à la bèche que l'on fait en silence en toutes circonstances, que ce soit dans le rêve ou à l'état de veille. Bref, la période de gestation. Personne n'a jamais réussi à jeter sur le papier ce qu'il avait primitivement l'intention de dire. La création originale, qui est continue, que l'on écrive ou non, participe du flux élémentaire. Elle s'inscrit hors de toutes dimensions, de toutes formes, de toutes durées. Dans cet état préliminaire, qui est création et non naissance, les éléments appelés à disparaître ne sont pourtant nullements détruits; un principe qui se trouvait déjà être présent, marqué au sceau de l'impérissable, par exemple la mémoire, la matière, Dieu, surgit à l'appel et l'être s'y précipite comme le fétu de pailledans le torrent. Mots, phrases, idées, si subtils et ingénieux soient-ils, coups d'ailes les plus forcenés de la poésie, rêves les plus profonds, visions les plus hallucinantes, ne sont que hiéroglyphes grossiers gravés par la douleur et la souffrance en commémoration d'un événement qui demeure intransmissible.
Dans un monde suffisamment ordonné, il serait utile de faire l'effort déraisonnable de noter de tels hasards miraculeux. Cela n'aurait à vrai dire aucun sens. Si l'humanité prenait le temps de se rendre compte des choses, qui saurait se contenterd'une contre-façon, quand il n'est que de tendre la main pour saisir le réel? Qui aurait envie d'allumer la radio pour écouter Beethoven, par exemple, dès lors qu'il lui suffirait de se tourner vers lui-même pour vivre les extases d'harmonie que Beethoven a désespérément tenté d'enregistrer? Toute grande oeuvre d'art, si elle atteint la perfection, sert à nous rappeler, mieux: à nous faire rêver l'intangible éphémère, c'est-à-dire l'univers. Elle ne jaillit pas de l'entendement, on l'y admet ou on l'en rejette. Admise, elle instille une vie nouvelle. Rejetée, nous en sommes diminués d'autant. Quel que soit son objet, elle ne l'atteint jamais: elle contient toujours un plus dont le dernier mot ne sera jamais dit. Et ce plus, c'est ce que nous lui ajoutons dans notre appétit terrible de ce dont chaque jour qui s'écoule est la négation. Si nous nous admettions nous-mêmes aussi complètement que nous admettons l'oeuvre d'art, l'univers entier de l'art périrait de carence alimentaire.
Henry Miller, Sexus (Bourgois, 1995)
traduit de l'américain par Georges Belmont
image: Henry Miller, Really the Blues
15:23 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
10/04/2012
Valérie Zenatti
 Valérie Zenatti, Les âmes soeurs (Editions de l'Olivier, 2010)
Valérie Zenatti, Les âmes soeurs (Editions de l'Olivier, 2010)
On dit que toutes les âmes ont été façonnées deux par deux à la Création, à partir de la même matière sensible, avant d’être séparées. Depuis, elles sont à la recherche l’une de l’autre et lorsqu’elles se retrouvent, elles n’ont pas besoin de parler pour se reconnaître. Ce sont les âmes sœurs.
Tel est le cadre de cet épatant roman conjugué au féminin, dont l’un des deux personnages, Lila, délivre la clef.
Un beau matin Emmanuelle, épouse d’Elias, mère de famille, pas franchement dépressive mais consciente de s’enfoncer dans la routine, la grisaille et l’ennui, décide de prendre un jour de liberté, afin de stimuler ce besoin d’exister qu’elle nourrissait au temps de sa jeunesse. Ce moment unique, elle le consacre pour l’essentiel à la lecture d’un livre qui dévoile la confession de Lila, reporter de guerre, photographe, illuminée par une passion auprès de Malik – victime d’un accident mortel – dont le deuil paralyse ses activités, la prive de repères, avant que le temps imperceptiblement ne l’invite, dans une quête de ses origines, à se construire une nouvelle vie où les ombres du passé s’estompent peu à peu, sans trahir ni mentir.
Autant Lila incarne un personnage fort qui a mordu la vie à pleines dents, a connu et aimé les situations extrêmes, autant Emmanuelle, plus effacée, a passé à côté du grand amour avec Gabriel, et peine à se consoler de la disparition de sa meilleure amie, Héloïse, emportée par un cancer. Son plaisir de lecture, ainsi que la fascination qu’exerce Lila vont raviver ces douleurs, mais aussi lui permettre de se réconcilier avec elle-même et envisager l’avenir avec davantage de clairvoyance, d’harmonie et de reconnaissance.
Une histoire délicate et attachante qui appartient à tout le monde, car tous un jour, nous franchissons la porte d’une librairie ou d’une bibliothèque pour nous approprier un roman, rêver une autre vie avec ses personnages qui déposent dans notre fragile espace intérieur ces fleurs rares qui transfigurent notre quotidien et l’envahissent parfois d’une saveur si particulière.
Auteur de livres pour la jeunesse et traductrice de Aharon Appelfeld, Valérie Zenatti signe en 2006, aux Editions de l’Olivier, En retard pour la guerre, adapté pour le cinéma par Alain Tasma sous le titre Ultimatum – avec Gaspard Ulliel, Jasmine Trinca, Michel Boujenah et Anna Galiena - disponible en coll. Points/Seuil depuis 2009.
Les âmes soeurs est également disponible en format de poche (coll. Points/Seuil, 2011)
00:03 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2012
Steven Carroll 1b
Steven Carroll: Le rire - extrait

La première chose que j'entends quand les applaudissements s'apaisent, c'est son rire. Ce rire de Vic dont je suis tombée amoureuse la minute où je l'ai entendu pour la première fois. Il était tout entier dans ce rire. Un rire immense, sans la moindre trace de moquerie. Rien à voir avec les petits sourires en coin de George Bedser, ou les grognements de Bruchner. Un grand rire généreux, qui vous donnait envie de vous blottir dans son ombre. Qui vous donnait envie de rire avec lui, même si on ne savait pas pourquoi on riait.
A peine ai-je entendu son rire que l'évidence m'a frappée: ce n'est plus le même rire. Il y manque quelque chose. Ce rire-là ne m'est pas familier. Il a perdu sa générosité, il n'est plus que bruyant.
Vic discute avec George Bedser. Ils éclatent de rire encore une fois, puis Bedser s'éloigne. Vic n'est jamais en reste pour trouver des interlocuteurs quand il en a envie. Peu importe où il est. Dans le plus perdu des villages, il sautera sur la moindre occasion de parler à quelqu'un. Mais je le connais, celui-là, s'écriera-t-il tout à coup au fin fond de la plua reculée des campagnes, attends un peu que j'aille lui dire un mot. Mais Bedser s'est éloigné, et Vic me lance un regard en biais parce qu'il sait d'avance ce que je m'apprête à lui dire.
Je vois qu'il a l'allure avachie des ivrognes. Son corps s'affaisse, des épaules aux genoux, qui ne tarderont pas à fléchir à leur tour. Ils sont tous pareils dès qu'ils ont quelques verres dans le nez. Des bonshommes de cire fondant au soleil. Pas un n'y échappe. Vic n'en est pas encore tout à fait là, mais il en prend le chemin. Je commence à le connaître, depuis le temps. Et quand il relève les yeux, , j'y vois cette lueur hagarde qu'ils ont tous. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et faut-il que je lui parle de son rire par la même occasion? Faut-il que je lui dise que depuis un certain temps il ne me donne plus envie de rire avec lui? Que ce n'est plus le rire que j'aimais autrefois? Au lieu de lui faire écho, j'ai seulement envie de lui dire de se taire. J'aimerais qu'il puisse entendre son rire comme je l'entends ce soir, et qu'il s'arrête. J'aimerais qu'il se calme un peu sur la bière. Tandis que je traverse le salon en retournant toutes ces questions dans ma tête, il me regarde comme s'il savait déjà ce que j'ai l'intention de lui dire.
Si je le lui dis, je deviens une emmerdeuse. Personne ne souhaite passer pour une emmerdeuse. Les femmes des autres peuvent bien jouer à ce jeu-là, moi, je ne m'y prêterai pas. Jamais je ne m'abaisserai à ça. Je m'en irai avant. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors nous restons debout côte à côte sans rien nous dire, comme deux étrangers sur une piste de danse. Et cela pourrait être agréable, car nous avions été autrefois des étrangers qui se taisaient ensemble et prenaient du bon temps. A ceci près qu'alors nous avions toute une vie devant nous. C'était un silence nourri de promesses. Un silence joyeux. Aujourd'hui, la joie a disparu. Le silence qui nous échoit à présent n'est plus celui qui vous emplit quand vous avez l'impression que votre vie va décoller comme une fusée pour Mars. Ce n'est plus le silence qui précède les confessions fiévreuses que vous vous apprêtez à faire à l'homme de votre vie. Le silence que nous partageons désormais, c'est le silence triste et familier qui retombe après que l'on s'est tout dit.
En sorte que je suis soulagée quand les discours reprennent. Ils nous évitent de nous adresser la parole. Ils nous permettent de rire chacun de notre côté, puisque c'est aux plaisanteries d'un autre que nous rions. Et je sais déjà que quand j'entendrai son rire, ce ne sera plus le rire que j'ai tant aimé autrefois.
Steven Carroll, De l'art de conduire sa machine (Phébus, 2001)
image: Steven Carroll et son fils Leo
00:17 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Steven Carroll | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2012
Morceaux choisis - Pavel Kohout
Pavel Kohout

En moins de rien, Simsa se vit passer autour du cou un triple S qui, en temps normal, l'eût gonflé de fierté comme pédagogue et rongé d'envie comme collègue. Il avait été prévu à l'origine qu'à ce moment Simon, remplacé en dernière heure par Frantisek, lui attacherait les mains. Mais les quatre garçons formaient une équipe déjà si parfaitement soudée qu'ils avaient décidé, sans même se donner le mot, de transformer en triomphe une victoire qu'ils savaient désormais acquise.
Les prémonitions d'un bon pédagogue n'ont d'égale que celles d'une mère. Avant même qu'ils l'ussent conçu, Vlk avait compris leur dessein, et il en fut pétrifié. Pendre un client - a fotiori un homme du métier, même mis en condition - sans lui lier les mains était d'une telle inconscience ou témérité que c'était proprement tenter les dieux. Vlk frémit en voyant déjà Simsa faire d'une main un rétablissement de gymnaste sur le bras de la lanterne et desserrer de l'autre le noeud coulant pour se recevoir sur les pieds au milieu de l'assistance. Attachez-le! Attachez-le! faillit-il leur crier, maisdéjà les garçons l'avaient devancé.
Hep! lancèrent Albert, Frantisek, Petr et Pavel d'une seule voix, les deux premiers en ramenant à eux d'un trait continu la corde, les deux autres en soulevant le fardeau avant de se joindre aux haleurs. Simsa, toujours assis en tailleur comme un Bouddha, se vit ainsi lentement mais puissamment hissé par le cou au-dessus de la tête des mômes, la parole et le souffle coupés, mais non le reste. Il lança les bras en avant quand, de ses yeux exorbités, il vit tout près de lui - la personne connue, pensa-t-il joyeusement, c'était donc elle! - le visage aimé de Lizinka.
Dans sa conscience expirante et galvanisée, et par conséquent folle, la conviction se fit jour qu'il sortait enfin d'un mauvais rêve pour se réveiller dans un monde merveilleux. Il perçut un bruissement d'eau, sûr maintenant qu'il s'était endormi dans la baignoire de sa maison de campagne, enveloppé de la tiédeur de ce corps de jeune fille qui n'avait cessé de l'attendre. De surprise, il laissa retomber les bras qui heurtèrent au passage son membre durci. Il sourit - son impuissance n'avait donc été qu'une fable! - et referma les mains sur les seins délicats. Mais c'était déjà un autre rêve, et le dernier, puisque Lizinka, de sa délicate main gauche, lui serrait le menton, tandis que sa non moins délicate main droite lui empoignait les cervicales pour exécuter aussitôt après un brise-nuque digne du manuel scolaire.
Pavel Kohout, L'exécutrice (Albin Michel, 1980)
23:35 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2012
Morceaux choisis - Guy de Maupassant
Guy de Maupassant

L'établissement, unique dans la petite ville, était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue si comme il faut; elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde; son bon coeur était si connu, qu'une sorte de considération l'entourait. Les habitués faisaient des frais pour elle, triomphaient quand elle leur témoignait une amitié plus marquée; et lorsqu'ils se rencontraient dans le jour pour leurs affaires, ils se disaient: A ce soir, où vous savez, comme on se dit : Au café, n'est-ce pas? après dîner. Enfin la maison Tellier était une ressource, et rarement quelqu'un manquait au rendez-vous quotidien.
Or, un soir, vers la fin du mois de mai, le premier arrivé, M. Poulin, marchand de bois et ancien maire, trouva la porte close. La petite lanterne, derrière son treillage, ne brillait point; aucun bruit ne sortait du logis, qui semblait mort. Il frappa, doucement d'abord, avec plus de force ensuite; personne ne répondit. Alors il remonta la rue à petits pas, et, comme il arrivait sur la place du Marché, il rencontra M. Duvert, l'armateur, qui se rendait au même endroit. Ils y retournèrent ensemble sans plus de succès. Mais un grand bruit éclata soudain tout près d'eux, et, ayant tourné la maison, ils aperçurent un rassemblement de matelots anglais et français qui heurtaient à coups de poings les volets fermés du café. Les deux bourgeois aussitôt s'enfuirent pour n'être pas compromis, mais un léger pss't les arrêta: c'était M. Tournevau, le saleur de poisson, qui, les ayant reconnus, les hélait. Ils lui dirent la chose, dont il fut d'autant plus affecté que lui, marié, père de famille et fort surveillé, ne venait là que le samedi, securitutis cuuia, disait-il, faisant allusion à une mesure de police sanitaire dont le docteur Borde, son ami, lui avait révélé les périodiques retours.
C'était justement son soir et il allait se trouver ainsi privé pour toute la semaine. Les trois hommes firent un grand crochet jusqu'au quai, trouvèrent en route le jeune M. Philippe, fils du banquier, un habitué, et M. Pimpesse, le percepteur. Tous ensemble revinrent alors par la rue aux Juifs pour essayer une dernière tentative. Mais les matelots exaspérés faisaient le siège de la maison, jetaient des pierres, hurlaient ; et les cinq clients du premier étage, rebroussant chemin le plus vite possible, se mirent à errer par les rues.Ils rencontrèrent encore M. Dupuis, l'agent d'assurances, puis M. vasse, le juge au tribunal de commerce ; et une longue promenade commença qui les conduisit à la jetée d'abord. Ils s'assirent en ligne sur le parapet de granit et regardèrent moutonner les flots. L'écume, sur la crête des vagues, faisait dans l'ombre des blancheurs lumineuses, éteintes presque aussitôt qu'apparues, et le bruit monotone de la mer brisant contre les rochers se prolongeait dans la nuit tout le long de la falaise.Lorsque les tristes promeneurs furent restés là quelque temps,M. Tournevau déclara: Ça n'est pas gai. Non certes, reprit M. Pimpesse; et ils repartirent à petits pas.
Après avoir longé la rue que domine la côte et qu'on appelle Sous-le-Bois, ils revinrent par le pont de planche sur la Retenue, passèrent près du chemin de fer et débouchèrent de nouveau place du Marché, où une querelle commença tout à coup entre le percepteur, M. Pimpesse, et le saleur, M. Tournevau, à propos d'un champignon comestible que l'un d'eux affirmait avoir trouvé dans les environs. Les esprits étant aigris par l'ennui, on en serait peut-être venu aux voies de fait si les autres ne s'étaient interposés. M. Pimpesse, furieux, se retira; et aussitôt une nouvelle altercation s'éleva entre l'ancien maire, M. Poulin, et l'agent d'assurances, M. Dupuis, au sujet des appointements du percepteur et des bénéfices qu'il pouvait se créer. Les propos injurieux pleuvaient des deux côtés, quand une tempête de cris formidables se déchaîna, et la troupe des matelots, fatigués d'attendre en vain devant une maison fermée, déboucha sur la place. Ils se tenaient par le bras, deux par deux, formant une longue procession, et ils vociféraient furieusement. Le groupe des bourgeois se dissimula sous une porte, et la horde hurlante disparut dans la direction de l'abbaye. Longtemps encore on entendit la clameur diminuant comme un orage qui s'éloigne; et le silence se rétablit. M. Poulin et M. Dupuis, enragés l'un contre l'autre, partirent, chacun de son côté, sans se saluer. Les quatre autres se remirent en marche, et redescendirent instinctivement vers l'établissement Tellier. Il était toujours clos, muet, impénétrable. Un ivrogne, tranquille et obstiné, tapait des petits coups dans la devanture du café, puis s'arrêtait pour appeler à mi-voix le garçon Frédéric.
Voyant qu'on ne lui répondait point, il prit le parti de s'asseoir sur la marche de la porte, et d'attendre les événements. Les bourgeois allaient se retirer quand la bande tumultueuse des hommes du port parut au bout de la rue. Les matelots français braillaient la Marseillaise, les anglais le Rule Britania. Il y eut un mouvement général contre les murs, puis le flot de brutes reprit son cours vers le quai, où une bataille éclata entre les marins des deux nations. Dans la rixe, un Anglais eut le bras cassé, et un Français le nez fendu. L'ivrogne, qui était resté devant la porte, pleurait maintenant comme pleurent les pochards ou les enfants contrariés. Les bourgeois enfin se dispersèrent. Peu à peu le calme revint sur la cité troublée. De place en place, encore par instants, un bruit de voix s'élevait, puis s'éteignait dans le lointain. Seul, un homme errait toujours, M. Tournevau, le saleur, désolé d'attendre au prochain samedi; et il espérait on ne sait quel hasard, ne comprenant pas; s'exaspérant que la police laissât fermer ainsi un établissement d'utilité publique qu'elle surveille et tient sous sa garde. Il y retourna, flairant les murs, cherchant la raison; et il s'aperçut que sur l'auvent une pancarte était collée. Il alluma bien vite une allumette- bougie, et lut ces mots tracés d'une grande écriture inégale: Fermé pour cause de première communion. Alors il s'éloigna, comprenant bien que c'était fini...
Guy de Maupassant, La maison Tellier (coll. Livre de Poche, 2003)
00:08 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2012
Morceaux choisis - Jean Douassot
Jean Douassot (pseudonyme de Fred Deux)

Je les recollerai, je les recollerai.
C'était ma litanie, un chant, un murmure et une promesse. Ils ne pouvaient pas rester ainsi, elle sous un arbre, moi à côté, et lui derrière les vitres. Nous ne pouvions pas continuer à nous buter. Je n'avais pas de sentiments pour l'un plus que pour l'autre, mais il était impensable pour moi que ces deux être ne puissent arriver à s'entendre. D'autant que ramenant tout au plus simple, je trouvais que le fait de m'avoir, de me retrouver en meilleure santé après cette longue absence, tout cela devait amener une détente, une entente, et aussi de la joie. Je me mis immédiatement à espérer une vie tranquille. La vie serait si belle et douce, si douce, oui, si douce.
Rien ne me paraissait impossible, et une force nouvelle me poussa en pensée vers le bistrot; mon père était juste, il avait raison de jouer aux cartes, de boire, de rentrer tard. L'homme doit rentrer tard, un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme, et la mère doit l'attendre, ne rien dire, et se réjouir qu'après une journée de travail son homme aille se détendre. Donc le père est dans son droit. Je l'excusais en tout, et plus encore parce qu'il ignorait que nous l'attendions, que nous le pistions comme un lapin, que sa femme le traitait de fumier devant moi, son fils. La mère aussi était juste. Elle n'était qu'une femme, un peu coléreuse, mais bien vite, je ramènerais l'équilibre dans le camp. Ce qu'il fallait, c'était me laisser faire.
Sur ce point, aucun doute, j'aurai cartes blanches.
Relevant les yeux vers la vieille, je la retrouvai toujours tendue, de grosses larmes dégoulinant sur ses joues. Elle n'avait pas bougé d'un pouce, son maquillage, qu'il m'était difficile de voir dans le noir, avait dû subir de grandes modifications, car deux traits noirs, distincts, partaient de ses yeux et descendaient vers la bouche. Ses lèvres me parurent pâles, ayant perdu leur teinture rouge, et une blancheur, qui ressemblait à l'écorce de l'arbre lui donnait une allure tragique.
Mère, dis-je en lui tirant la manche, mère.
Je m'arrêtai, ne sachant quoi dire de plus. Devais-je lui dire que j'allais tout arranger? Que je me chargerais d'eux? De les rendre heureux. Que j'allais dire: venez et regardez-moi, je suis votre fils, c'est bien d'avoir un fils, j'étais malade, ma mère était malade, nous étions tous malades, et nous voilà tous guéris. C'est bien d'être guéris. C'est bien d'être ensemble, j'étais malheureux là-bas, vous ne pouvez pas savoir comme j'étais malheureux...
Jean Douassot, La Gana (Eric Losfeld, 1970)
image: Asylum - http://legrandclub.rds.ca
20:27 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












